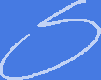L’année de mes onze ans, nous habitions encore le centre, dans une rue qui descend en forte pente depuis le quartier de Bel-Air, et, interrompue par un square au moment où elle retrouve l’horizontale, se prolonge puis se termine en s’abouchant en oblique avec l’artère principale de la ville.
En tous les cas elle était ainsi, à ce moment-là. Seul le côté gauche de la rue, dans la pente, était construit. Nous logions au cinquième étage, dans un appartement qui me paraissait alors spacieux, avec un balcon qui donnait sur la rue, et un autre, plus petit et gris, sur la cour. Notre bâtiment était le premier d’un ensemble récent qui, avec d’autres constructions de même acabit, formait un U, au centre duquel on avait construit des garages.
Un de nos passe-temps favoris consistait à descendre à vélo, sans freiner, depuis le haut de la rampe d’accès à la cour, et à terminer notre course dans la porte du garage qui se trouvait en face. La peur du choc et sa violence, qui pouvait à chaque tentative nous faire tomber, nous excitaient et nous faisaient frissonner. Nous, c’était Pascal et Bruno, deux frères dont le premier était aussi brun que son aîné était blond, et qui habitaient un peu plus haut dans la rue, Régis, toujours habillé en bleu marine et blanc, qui, lui, demeurait au rez-de-chaussée d’un immeuble lové au creux du U, et donc moi, pour compléter ce fameux quatuor de garçons bien trop sages, malgré les apparences. Nous provoquions, en heurtant le panneau de bois, un bruit fort, qui était amplifié par la hauteur des immeubles serrés autour des garages. Régulièrement, notre jeu cessait sous les réprimandes criées depuis un balcon par une mère agacée ou hurlées par un père dérangé dans son repos. Nous nous calmions pour quelques heures, quelques jours parfois, avant de reprendre de plus belle.
Un soir de cet été 1966, nous avions corsé le jeu, sur une idée de Bruno, qui était aussi le plus âgé de la bande. Nous avions équipé nos vélos d’une feuille de carton, découpée dans des boîtes de sucre, repliée en plusieurs épaisseurs, et fixée sur un des rayons de la roue arrière par une pince à linge en bois. La descente infernale se déroulerait dans la rue et allait débuter le plus haut possible vers Bel-Air, et, toujours sans freiner, nous devrions achever (c’était bien le mot) notre course contre le pneu d’une voiture stationnée le long du trottoir, juste avant le square, et spécialement désignée pour nous servir de butoir. Les roues vrombissaient, nous donnant un sentiment de puissance, chevauchant nos engins aux « moteurs » fracassants, et nous ne craignions rien ! L’air devenu plus frais nous fouettait le visage. On criait pour s’encourager, et le choc nous faisait glisser de nos selles. Je m’étonne encore qu’aucun de nous ne se soit blessé dans ce jeu-là. Je m’étonne aussi que nos parents nous aient laissés dans la rue à la nuit tombée. De quel stratagème avions-nous usé pour obtenir le droit de rester aussi tard dehors ? Puis le jeu nous lassa. Nous nous retrouvâmes assis et désœuvrés sur les marches de mon allée. La nuit avançait, couvrant d’ombres l’autre côté de la rue. Car il y avait l’autre côté de la rue… Qui eut le premier l’idée de traverser pour nous rendre dans le Terrain Vague ?
Je fais juste un petit aparté, pour parler de Christine. Elle était la jeune sœur de Régis, et Pascal et moi en étions amoureux. La belle, dont les longs cheveux clairs étaient toujours plaqués par un turban bleu, en accord avec sa sage tenue, était sans doute flattée de cette cour. En tous les cas, elle ne se décidait pas à choisir, et nous soupirions à ses pieds. Souvent, nous nous hissions dans la chambre de Régis, par la fenêtre qu’il nous ouvrait de l’intérieur. Sa mère, sans doute occupée à la cuisine, ne devina jamais que nous nous introduisions dans les lieux avec le curieux dessein de nous livrer au concours du plus long baiser sur les lèvres que notre amoureuse gardait désespérément pincées.
Le Terrain Vague ! Au milieu de broussailles, d’arbrisseaux, de buissons de ronces et d’orties qui exhalaient leur parfum de menthe, les jours les plus chauds, apparaissait çà et là ce qui restait d’une ancienne usine, des murets en béton, dépassant à peine de la végétation, et des dalles de ciment, soulevées en morceaux entiers par la terre, comme si elle-même avait été soufflée par en dessous. Au fond du terrain, et remontant jusqu’à une rue supérieure, il y avait le crassier, un pan de colline formé des déchets de l’ancienne cokerie, qui avait alimentée le chauffage urbain, avant sa destruction sous les bombardements de la dernière guerre. Bien entendu, l’endroit nous était interdit, eu égard à tous les périls qu’il présentait : trop de jeux dangereux pouvaient y être inventés ! Bien entendu, nous les avons tous imaginés…et testés : descendre la pente du crassier sur des luges faites de cartons d’emballages aplatis, courir dans les buissons au risque de tomber dans un trou ou de s’empaler sur un fer surgissant des ruines, fumer, cachés dans les bosquets, du sureau qui nous brûlait la gorge. D’autres bandes partageaient notre terrain de jeu, mais nous les évitions prudemment, préférant nous épargner tout risque de conflit. La nuit tombée, nous nous éloignions de l’endroit : les ombres devenaient inquiétantes, on murmurait des histoires sordides sur de pauvres hères qui auraient élu domicile ici, bien que nous n’en ayons jamais croisé un seul. Régulièrement, cependant, on y apercevait des feux crépitants, une fois le crépuscule installé.
Ce soir-là, nous avons donc bravé notre propre interdit. Si Pascal et moi avions élu Christine dans notre cœur, Bruno, lui, était tombé éperdument amoureux d’une fille, plus grande que nous tous, que nous croisions de loin, dans le Terrain Vague, en compagnie d’une bande d’adolescents d’un quartier voisin. La fille était belle, mais l’on se moquait facilement de Bruno, en lui disant qu’il était amoureux d’une vieille. La vieille en question devait aller sur ses quatorze ou quinze ans, je pense. Elle montrait déjà le corps d’une femme, même si elle était la plupart du temps habillée comme un garçon, pantalon de toile et polo. Elle maintenait ses cheveux bruns sous une casquette plate. Mais quand sa coiffure s’échappait, dans sa course, ses longs cheveux bruns cascadaient sur ses épaules, provoquant chez Bruno des hurlements de bête en émoi, nous faisant rire aux éclats. À plusieurs reprises, à l’heure où la lumière est « entre chien et loup », nous avions pu la voir, en compagnie de sa bande, faite de garçons sans doute de son âge mais qu’elle dépassait tous d’une tête, descendre le long du crassier, alors que nous-mêmes songions à rentrer. Bruno nous arrêtait pour attendre qu’elle passe près de nous, et elle plantait son regard dans le sien, j’en suis sûr encore aujourd’hui, lorsque son groupe se trouvait encore à vingt mètres de nous et bifurquait pour s’enfoncer dans les broussailles.
Si ce n’est pas Bruno qui émit l’envie de passer outre les instructions parentales, ce soir-là, il fut le premier à franchir le seuil du Terrain. Sans même nous attendre, il se dirigea, courbé en deux, en direction de la lueur d’un feu, assez loin de nous pour que nous plongions d’abord dans une obscurité d’une densité inquiétante. Nous connaissions le lieu par cœur, chacun des petits sentiers qui le quadrillaient avait été maintes fois foulé par nos pieds. Mais avec l’obscurité, tout changeait. Telle piste ne croisait plus telle autre au même endroit, tel buisson aurait dû se trouver juste devant tel petit mur. La nuit venue, chaque élément trouvait une autre place, et leur taille était différente. Bruno nous précédait sans nous attendre, et ne semblait aucunement troublé par la nouvelle configuration des lieux. Il était comme guidé, et en quelque sorte protégé dans sa course, par un ange qui savait aussi bien que lui qu’elle était là.
Et effectivement, elle était là, tout près du feu, son profil éclairé par une lueur rouge. Nous rejoignîmes Bruno, accroupi depuis plusieurs minutes, semblait-il, et qui nous imposa le silence. Ils étaient six, en tout. Les garçons, pour la plupart, dansaient autour du feu, excités, criants, gesticulants. Deux d’entre eux, assis près d’elles, fumaient, et d’autres buvaient, le goulot de grandes bouteilles de bière collé à leurs lèvres. Elle fumait aussi, ce qui nous confirma que c’était une vieille.
Nous ne bougions pas, tétanisés, mais aussi pressentant un indicible danger, si nous faisions connaître notre présence. Il y avait quelque chose de spécial ce soir-là, dans l’atmosphère, comme l’annonce d’un grave événement.
À un moment, l’un des garçons jeta sa chemise, qu’il venait d’ôter, dans les flammes. Le feu, qui avait perdu un peu d’ardeur, repartit de plus belle, l’espace d’un instant, le temps de se nourrir du nouveau combustible. Les adolescents, y compris la fille, crièrent. Il y avait plus que de la joie dans leurs hurlements. Un autre garçon jeta à son tour son vêtement. Ses vêtements devrais-je dire, car il avait ôté aussi son short. Enfin, bientôt, sans que nous le réalisions, ils se déshabillèrent tous, jetant leurs habits dans le foyer, ravivant les flammes, qui montaient haut dans le ciel. Nous ne disions rien, mais nous cherchions tous la fille des yeux. Où était-elle ? Nous ne la trouvions pas.
Et puis, glissant à gauche du feu, nous l’aperçûmes, dansant entièrement nue elle aussi. Nous n’avions jamais vu le corps d’une femme : nous restâmes fascinés. Tant de mystères nous étaient tout à coup dévoilés.
Mais, à peine sortis de notre innocence, nous allions être confrontés à la plus dure des réalités. À présent, leur danse ressemblait étrangement à ce que nous pouvions voir à la télévision, dans les westerns du dimanche après-midi. Leurs chants devenaient des hymnes. Nous venions juste de remarquer les visages barrés de traces noires, comme des peintures guerrières. La fille aussi avait marqué ses joues de ces signes, comme autant de preuves de la solennité de l’instant. Chacun, à leur tour, les six adolescents prenaient leur élan, s’envolaient au-dessus du foyer, et disparaissaient dans la pénombre. Une odeur âcre se dégageait des flammes, qui étaient de plus en plus hautes, les obligeant à redoubler d’efforts pour échapper aux brûlures…
De manière complètement incompréhensible, l’un d’eux sembla prendre moins d’élan et quand il passa, trop bas, au-dessus du foyer, le feu lécha ses jambes. Instantanément, le corps entier s’embrasa et retomba lourdement sur le sol, à quelques mètres de ses compagnons. Au lieu de lui porter secours, sans même qu’aucun d’eux ne pousse de cris d’effroi, ils s’élancèrent l’un après l’autre au-dessus des flammes, et chacun à leur tour, ils s’enflammèrent, au plus haut de leur saut, avant de choir brutalement sur la terre. Il y avait un sifflement dans l’air, comme lorsqu’on attise le feu d’un âtre, pendant l’interminable laps de temps que durait la chute de leur corps. L’odeur de chair calcinée m’évoquait, sordidement, le buclage des pattes de poulets, que mon père exécutait, pour en ôter les dernières plumes, sur les feux de la gazinière, le dimanche. Je ne trouvais même pas cela stupide. J’étais terrorisé. Nous étions terrorisés. Les mains de mes amis se serraient sur mes bras, je serrais les miennes sur les bras les plus près des miens. La fille fut la dernière à s’élancer, cherchant à peine à prendre de la hauteur. Ses cheveux alimentèrent, autour de son beau visage, une lumineuse couronne de feu, lui conférant irrévocablement son statut de fée, et je suis certain qu’elle nous regarda à ce moment-là. Pas seulement Bruno, mais chacun de nous, imprimant en nos âmes comme un message dont nous ne comprenions pas le sens. Elle resta dans les airs encore plus longtemps que tous les autres, pour que nous saisissions bien toute la magnifique terreur du moment. À travers les flammes, les formes de son corps paraissaient étrangement intactes, malgré la rougeur de la carnation. Elle s’effondra sur la terre, plus près de nous que les autres. Au lieu de nous précipiter hors du terrain vague, comme mus par une force qui nous dépassait, nous nous levâmes d’un bond et approchâmes de ce qu’il restait des six adolescents. Les dépouilles avaient cessé rapidement de se consumer. En lieu et place de chacune d’elles, il y avait des sacs en toile de jute, comme ceux qui emballent les pommes de terre (c’est à cela que je pensais en premier, et à quoi je devais penser longtemps) ou bien le charbon. Ils étaient là, comme oubliés depuis longtemps, les uns plus ou moins roulés en boule, les autres convenablement étalés. Aucune trace de l’existence des garçons et de leur compagne ne subsistait. Les six vies avaient été effacées en quelques brèves secondes, et leurs cendres remplacées par ces ridicules choses, comme pour entériner la vacuité de leur existence à peine commencée. Bruno cria enfin, et nous nous libérâmes alors ensemble dans des hurlements d’horreur. Je criais longtemps, jusqu’à me réveiller en sueur, assis dans mon lit, pleurant toutes les larmes de mon corps. Je ne me rendormis pas de la nuit, essayant de toutes mes forces de reconstituer la soirée de la veille. Je voyais notre partie de vélo, je nous voyais encore assis sur les marches de mon immeuble, avant de décider de traverser le Terrain Vague. Je revois le feu, mais si flou, que je ne pouvais plus distinguer qui se trouvait près des flammes. Je ne savais déjà plus comment était la fille, mais je voyais quand même nettement ses grands yeux noirs posés sur nous.
Le lendemain matin, je partais en vacances, et, à mon retour, notre famille avait déménagé. Je ne sais plus rien, ni de mes copains d’enfance, ni des amours de Christine, ce qu’ils sont devenus, comment ont-ils construits leur vie, s’ils repensent souvent, comme moi, à cette nuit effroyable et si quelques signes jalonnent parfois leur vie. Dans mes premières histoires, plus tard, j’inventais un personnage du nom de Korrigan[i], dont je croyais pêcher le nom dans mon imagination. Peut-être était-ce justement un indice que m’envoyait la Fée du Terrain Vague, pour m’assurer de sa bienveillance ? Au long de mon existence, j’ai souvent fonctionné à l’instinct, confondu passion et raison. Je me suis défié en me situant dans des rôles pas écrits pour moi. Et j’ai souvent eu de la chance. Ou bien ai-je été guidé ?
» S’inquiéter, désirer. Ce que l’on veut, et ce que l’on a peur d’essayer. Ce que l’on a été, ce que l’on veut devenir. «
Stephen King, Ça
[i] Korrigan, e n. (ancien breton). Nain ou fée des légendes bretonnes, tantôt bienveillant, tantôt malveillant. Larousse