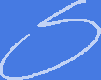Ouverture
19 octobre 2022
La mère de l’arrière-grand-mère de ma grand-mère s’appelait Salomé Chiaramonti.
Elle est née en 1827. Je suis née en 1989 et je m’appelle Salomé Chiaramonti. Nous portons le même prénom et le même nom de famille et cela n’aurait pas dû se produire. Il n’y a pas eu d’autres Chiaramonti entre elle et moi. Sa fille s’est nommée Durandeau, puis il y a eu Bisson, Jeunet, Leenhardt et ma mère, Claire Fabre, a rencontré Paul Chiaramonti. Ils se sont connus sur les bancs de l’université à Lille et ne se sont plus quittés : une seule année s’était écoulée quand je suis arrivée.
Autre hasard du destin, mon aïeule était, apprendrais-je par la suite, journaliste pour La Presse, un quotidien parisien – une des rares femmes dans la profession à cette époque ; moi, je suis journaliste à Libération – où je suis loin d’être unique.
Le journal vient de me confirmer dans mon poste. Nous sommes le 19 octobre et je fête mes trente-trois ans avec ma famille et mes amis les plus proches.
En guise de cadeau, ma grand-mère m’a remis un paquet d’enveloppes bleu clair, vieillies, liées entre elles par un ruban plus sombre. Elle est restée très énigmatique en me le confiant. J’ai résisté et attendu de me retrouver seule pour dénouer l’attache qui retenait ensemble onze lettres. Au dos de chacune, on pouvait lire, en caractères joliment formés, Salomé Chiaramonti. La première datait de novembre 1860, la dernière de septembre 1861.
Je n’ai pas compris immédiatement qui était cette femme qui portait mon prénom et mon nom et dont personne ne m’avait jamais parlé. Mais les lettres m’ont donné quelques clés. D’abord, la destinataire était identique pour chacune : Louise Durandeau. Ce nom ne m’est pas inconnu, car plusieurs membres de notre famille s’appellent encore ainsi. Et au dos de la dernière enveloppe, quelqu’un avait eu la bonne idée d’ébaucher un arbre généalogique qui m’a montré que la grand-mère de ma grand-mère était la fille de cette Louise.
Du côté de mon père, ses arrière-grands-parents sont arrivés de Sicile un peu avant la Première Guerre mondiale. L’histoire dit que nous avons de lointaines origines françaises, des chevaliers de la noblesse dauphinoise, partis batailler en Italie et qui y demeurèrent. Leur nom passa de Clermont à Chiaramonti, sans doute par souci d’intégration. Installée dans le bassin lillois, ma famille paternelle n’a donc aucun lien avéré avec le Chiaramonti indiqué sur l’arbre, et qui donna son patronyme en 1827 à une fille baptisée Salomé, née peut-être en région parisienne, où il semble avoir vécu – quelqu’un avait noté « Paris ? » juste à côté. J’ai remarqué également qu’il n’y avait pas de date de décès pour cette femme, désignée comme étant la mère de Louise.
J’ai ouvert la première enveloppe. Elle contenait deux feuillets, saturés recto et verso d’une petite écriture noire, ronde et régulière. En haut de la première page était inscrit : « New York, le 20 novembre 1860 » et tout de suite en dessous, « Ma chérie ». Puis la lettre décrivait, dans un registre adoucissant la réalité, la traversée de l’Atlantique en bateau et l’arrivée de mon aïeule en Amérique. Suivait un long paragraphe où elle demandait à être pardonnée d’être partie seule, et combien Louise – alors âgée de huit ans, selon les dates que j’avais lu – serait à n’en pas douter heureuse de ces jours auprès de ses grands-parents. Sa dernière phrase indiquait qu’elle gagnait le matin même sa destination, Hartford, dans le Connecticut, « à quelques heures de New York » précisait-elle.
Mais aucun détail ne m’a renseigné sur ce que Salomé Chiaramonti était allée chercher là-bas.
1
J’avais embarqué au Havre le 4 novembre 1860, sur le SS Arago.
Le bateau allait mettre seize jours, par une mer souvent agitée, pour atteindre les États-Unis. Nous étions quatre-vingts voyageurs en première classe. Ma cabine comportait tout le confort utile à une agréable traversée. Je fus plusieurs soirs invitée à la table du commandant de bord, mais je ne faisais guère honneur aux repas, tant j’étais incommodée par le tangage incessant. Il y eut tout de même des moments plus calmes et, le ciel se dégageant, nous pûmes apercevoir des icebergs heureusement hors de notre route. Un jour, un officier me montra même une baleine qui nous accompagna quelques instants en nous gratifiant de son chant aigu.
À l’entrepont, les migrants étaient environ deux cents, entassés par dizaines dans des dortoirs rudimentaires, malgré le prix du billet. Pour la plupart, ils étaient allemands. Nombre d’entre eux craignaient de ne pas avoir le droit de rester sur le nouveau continent. La tension devint palpable quand le steamer s’engagea dans la baie de New York.
Après avoir dépassé Governor’s Island puis Ellis Island, et leurs forts hérissés de canons, il manœuvra très lentement pour accoster au port de Manhattan. Le débarquement fut impressionnant. Des hommes en uniforme forçaient les voyageurs qui descendaient du pont inférieur à se grouper en une masse compacte sur l’un des côtés du quai. Ils s’aidaient de la crosse de leurs fusils. Il y avait des cris et des larmes dans la foule. Une femme tenta même de me confier son enfant, une petite fille d’à peine cinq ans, pour qu’elle au moins gagne sa part de paradis. Je n’eus pas le loisir de décider quoi que ce soit, car les militaires veillaient au grain et renvoyèrent la gosse dans les jupes de sa mère en vociférant. Je les vis disparaître toutes deux derrière les murs de Fort Clinton, où se faisait le tri des postulants à l’aventure américaine. Pour ma part, grâce à l’invitation de mon hôte, j’avais un passe-droit en bonne et due forme et je franchis les contrôles en quelques minutes. Ce qui ne manqua pas de me mettre mal à l’aise face au dénuement de ces gens qui avaient fait la même traversée que moi.
Installée à l’hôtel Saint Nicholas, récent et luxueux établissement aux mille chambres distribuées sur six étages, à l’angle de Broadway et Broome Street, à Soho, je rédigeai un papier féroce au sujet des conditions réservées aux migrants durant la traversée puis à leur arrivée sur le nouveau continent. J’avais à peine relevé la plume que je m’effondrai, épuisée par le voyage et un sentiment d’oppression. Au cœur de la nuit, un orage de neige gronda longtemps. Les éclairs fracturaient le ciel noir moucheté d’épais flocons blancs. Je dormis peu, je fis des cauchemars peuplés de soldats hurlants. Leurs traits se déformaient jusqu’à devenir ceux de bêtes hideuses. Je fus heureuse de m’éveiller, même si c’était bien trop tôt.
Avant de prendre le train pour le Connecticut, où j’étais attendue, je remis mon article sous enveloppe à la réception de l’hôtel. Obligeant, le concierge s’engagea à le confier lui-même au service de poste d’un prochain bateau pour la France. Mon rédacteur en chef, Auguste Nefftzer, pesterait encore sur le ton contraire à la bienséance de mon papier. Il finirait par le publier en gommant ses aspérités, bafouant une fois de plus mon droit d’auteur, ce qui ne manquerait pas de me rendre folle ! J’avais également glissé avec les feuillets une lettre pour ma fille, ma chère Louise, que je ne verrais pas avant plusieurs mois.
J’avais tout d’abord refusé cette aventure. Je ne me sentais pas l’âme d’une biographe, surtout pas celle d’un homme jouissant d’une réputation aussi… sulfureuse, c’est le premier mot qui me vient à l’esprit. On disait de lui qu’il avait mené ses affaires sans beaucoup de respect pour les règles, qu’il s’agisse de loi ou de savoir-vivre. Malgré cela, il était inscrit dans son époque et conduisait aujourd’hui une industrie d’une modernité remarquable, capable de « produire en série des pièces interchangeables », selon son expression.
Son succès était tel qu’une mégalomanie sans limite l’avait gagné et cela ne pouvait que fasciner la presse. Jusqu’en France, on avait eu vent de la construction d’un manoir, d’une usine et d’un domaine extravagants. Quand il avait écrit pour demander qu’on m’envoie auprès de lui, quelques mois dans un premier temps, pour coucher sur le papier sa biographie, j’avais éclaté de rire. Mais Auguste n’avait pas trouvé ça drôle, surtout face à la rémunération proposée au journal. Pourquoi moi ? protestai-je. Parce qu’il a lu tes articles et qu’il aime leur style « volontiers irrespectueux », m’avait-il répondu en bougonnant. J’avais souri car ce style était effectivement l’objet de disputes incessantes entre mon rédacteur en chef et moi. La discussion avait tout de même duré plusieurs semaines et il avait fallu de forts arguments, argent d’un côté, menaces de l’autre, pour me convaincre. Après m’être documentée sur l’homme, j’avais décidé d’une posture, pensais-je, pour ne pas faire obligatoirement un portrait trop élogieux de Sa Majesté le roi du revolver.
Samuel Colt avait envoyé son secrétaire me chercher à la gare de Hartford. La voiture, un phaéton carrossé de boiseries à la patine dorée, menée par deux chevaux sous des capes en grosse toile, nous conduisit jusqu’au sud de la ville. La neige tapissait d’une fine couche blanche les pavés et les toitures. Je n’étais pas assez habillée. Par bonheur, d’épaisses couvertures en laine et en fourrure étaient à ma disposition. Mon guide ne parlait pas plus que nécessaire : son français était parfait pour le vocabulaire, mais son accent rendait incompréhensible le sens de ses propos. Je lui demandai de répéter à plusieurs reprises, et cela le fit rire si fort que ses éclats masquaient le bruit des sabots sur le sol gelé. Il s’était présenté, « Silvère Couture ! », précisant qu’il venait de Québec. L’homme était grand, dissimulé sous un bonnet taillé dans le pelage d’un animal et sous un épais manteau en fourrure également. Une barbe blonde et rousse lui mangeait le visage, si bien que je ne retenais de lui que ses yeux, très clairs, bleu presque blanc, piqués de deux petites pupilles noires. Il relevait plus du trappeur que du secrétaire, et j’avais du mal à l’imaginer derrière un bureau y accomplir une quelconque tâche rédactionnelle.